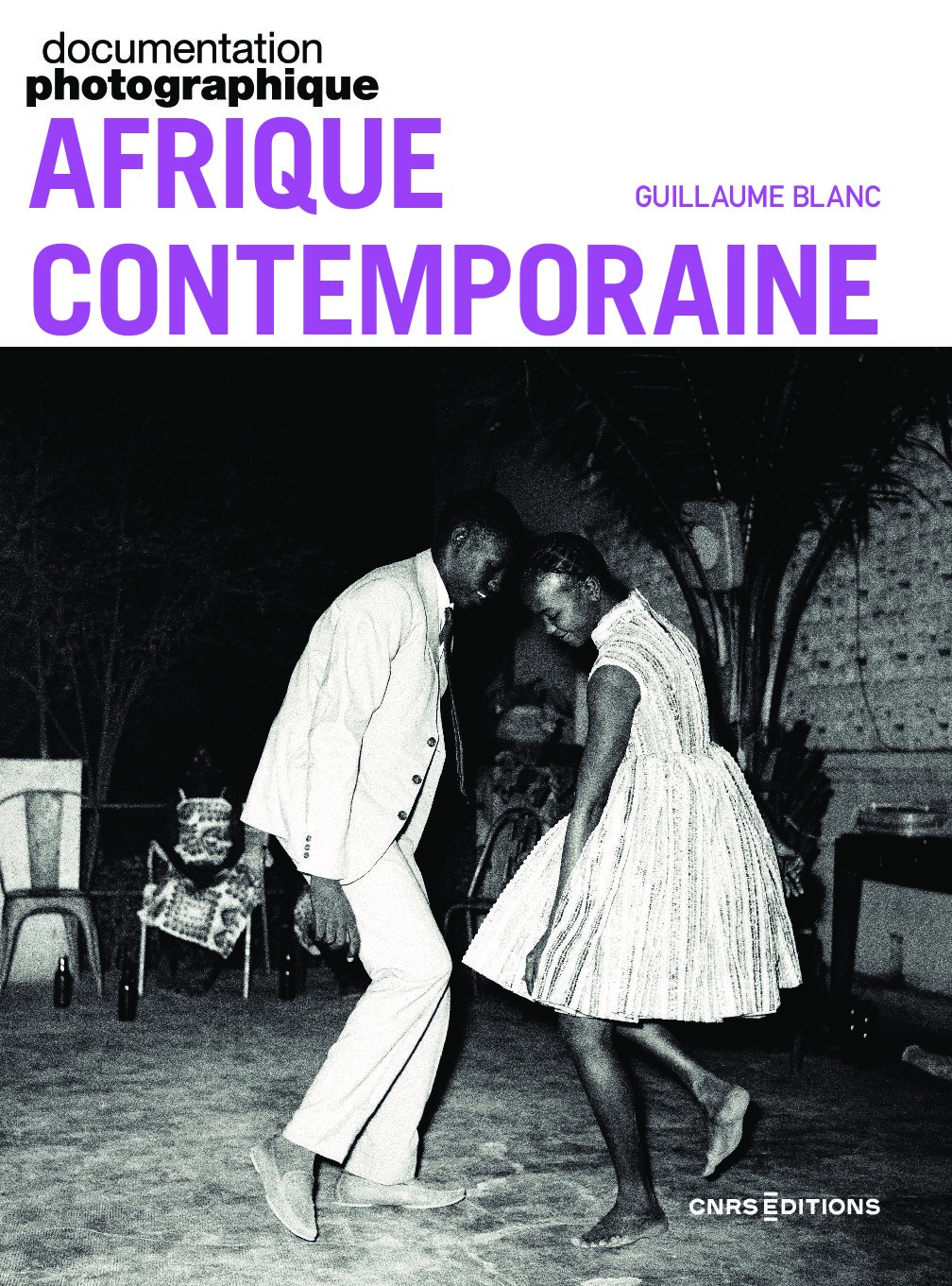Votre panier est vide.
N° 8165 – Mai 2025
€11,00
L’Afrique contemporaine :
Faut-il retenir le 18 mars 1962, ou le 5 juillet ? Épineuse question que se posent les élèves étudiant la guerre d’Algérie. Une guerre de huit ans, à propos de laquelle les programmes et les manuels scolaires indiquent clairement une même date de commencement : le 1er novembre 1954. Ce jour-là, le Front de libération nationale (FLN) lançait une série d’attaques contre les symboles de la présence française en Algérie – gendarmeries, casernes, ponts, routes, usines.
La date de fin est en revanche nettement moins évidente, car si les programmes et les manuels citent toujours scrupuleusement les accords d’Évian du 18 mars 1962, qui annonçaient le cessez-le-feu entre les soldats français et les combattants algériens, ils n’évoquent que brièvement la suite, à savoir l’indépendance de l’Algérie, proclamée le 5 juillet 1962. Alors quel jour faut-il retenir ? Idéalement les deux, bien
sûr. Mais lorsqu’elle s’enseigne par dates, l’histoire doit être économe, sans quoi les élèves le seront pour elle : la plupart d’entre eux ne se souviendront que d’une des deux dates. Reste donc à faire un choix doit-on insister sur le point de vue de la métropole et de l’armée française pour qui l’histoire s’achève le 18 mars, ou sur celui de la colonie et des populations algériennes pour qui, le 5 juillet, débutent l’indépendance et
le règne du FLN ?
La question peut sembler anecdotique, et pourtant, elle est au cœur de notre manière d’appréhender l’histoire de l’Afrique. En témoigne l’intitulé des questions d’histoire contemporaine qui furent inscrites au pro-
gramme, en 2022, des deux concours de l’enseignement secondaire : là où les candidates et les candidats à l’agrégation devaient étudier “Les sociétés africaines et le monde : une histoire connectée (1900-1980)”, celles et ceux qui se destinaient au CAPES devaient apprendre l’histoire de “L’Empire colonial français en Afrique […] de la conférence de Berlin (1884-1885) aux Accords d’Évian de 1962”.