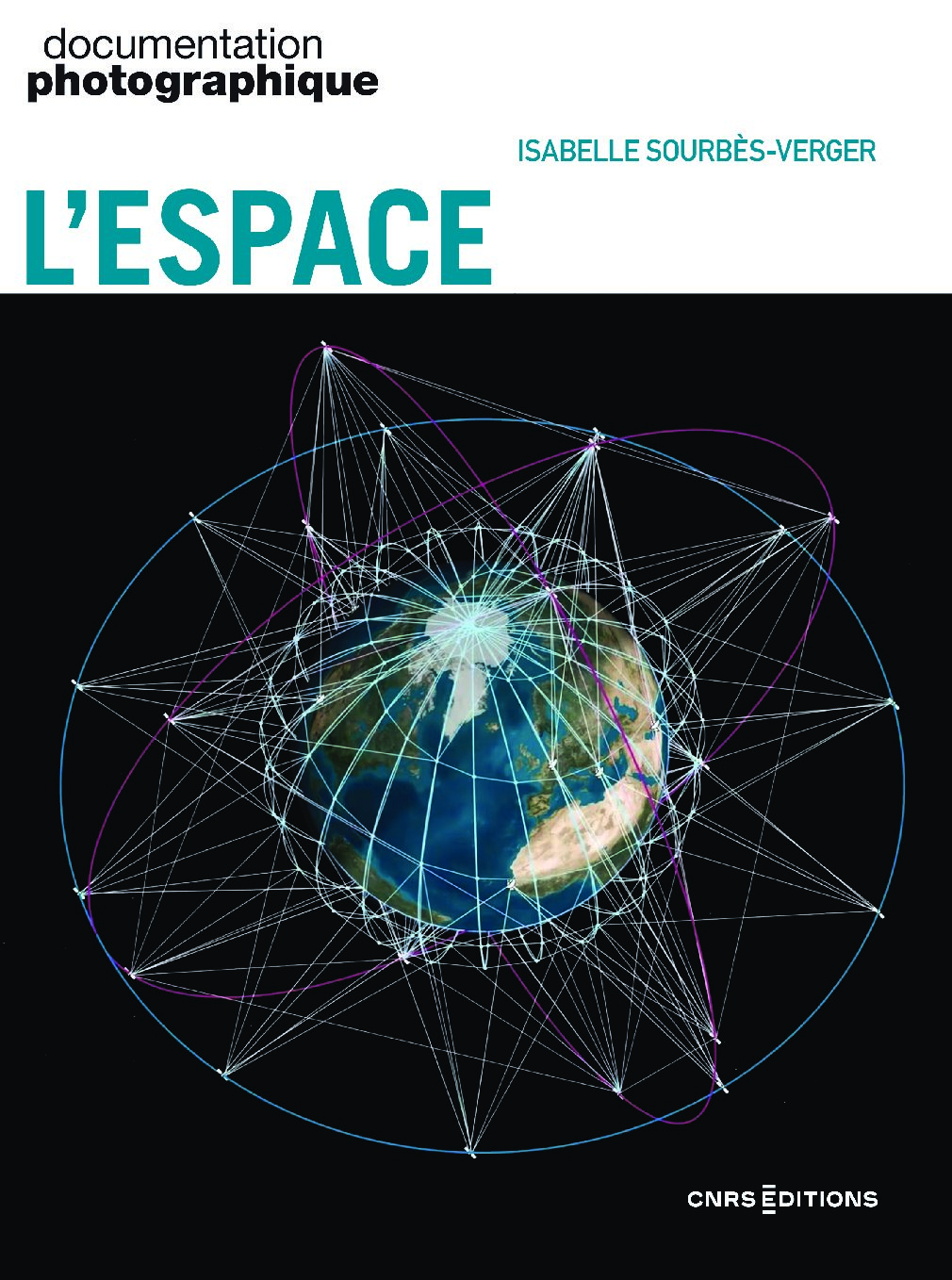Votre panier est vide.
Depuis la parution, il y a vingt ans, du remarquable numéro de la Documentation photographique consacré par Jérôme Baschet à la chrétienté médiévale, les études sur les sociétés médiévales, et particulièrement sur le rôle qu’y tient l’Église, se sont considérablement étoffées.
C’est sans doute sous l’angle du gouvernement de l’Église que l’historiographie s’est le plus renouvelée ces dernières décennies, en étroite articulation avec une histoire sociale du religieux, et plus encore une histoire des sociétés médiévales dans laquelle l’Église n’est pas pensée comme une structure extérieure au corps socio-politique, mais comme un de ses éléments, et un élément majeur.
Le projet qu’est la réforme “grégorienne”, quelles que soient les limites de sa mise en œuvre, visait à la fois à confondre Église et société et à assurer l’encadrement de la seconde par la première. Au cœur du Moyen Âge, les XIe-XIIe siècles constituent une période déterminante dans la structuration de l’Église comme institution ainsi que dans l’extension du champ de l’action ecclésiastique à tous les secteurs de la société, les deux aspects étant intimement liés.
Cependant, ces siècles centraux ne peuvent être compris sans prendre en compte la longue durée de l’histoire du christianisme latin, en particulier l’époque carolingienne. De même, les effets de la réforme “grégorienne” courent jusqu’à la fin du Moyen Âge et se produisent de manière concomitante avec le “tournant pastoral” amorcé à la fin du XIIe siècle par l’Église, qui met l’accent sur l’éducation des fidèles autant que sur leur encadrement, fût-ce par la contrainte.
Cet encadrement est assuré par des clercs formés, insérés dans une hiérarchie de juridiction, qui se pense d’abord comme une structure de déploiement de la grâce divine.